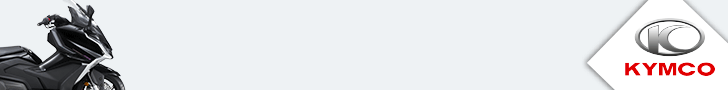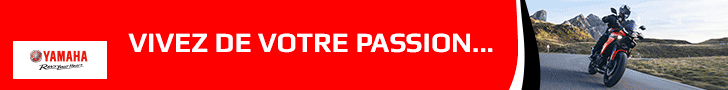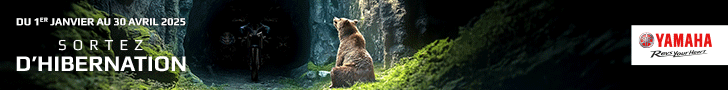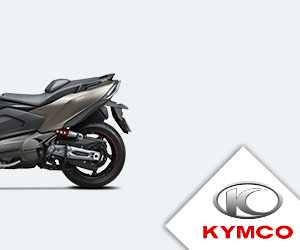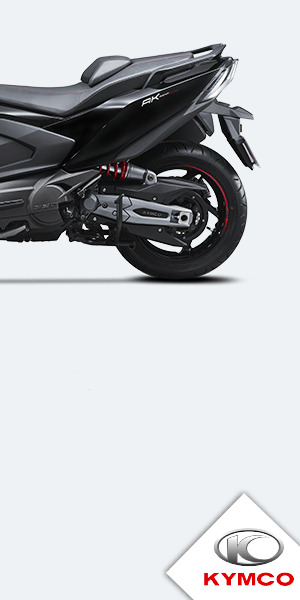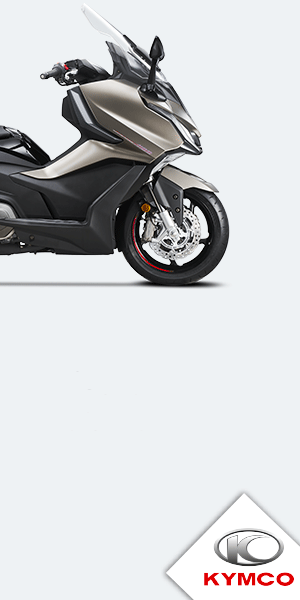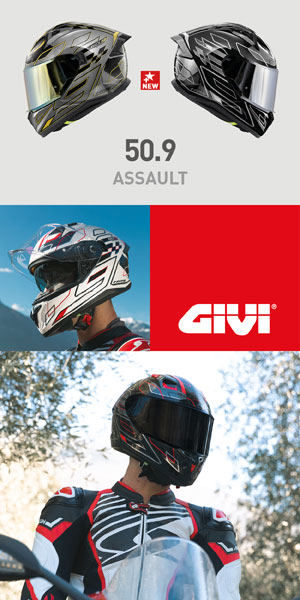Comme le nom de ce nouveau thème le laisse présager,
nous allons revenir sur des grands moments d’histoire pour les
questionner. Il peut s’agir de thématiques bien précises
mais aussi d’interrogations plus larges. Afin de vous faire un
avis, nous allons présenter les arguments favorables et
défavorables pour chacune de ces questions. Aujourd’hui,
penchons-nous sur l’un des plus gros transferts de l’histoire de
notre sport : Rossi chez Ducati.
I) Un peu de contexte
Après sept années de bons et loyaux services chez Yamaha (ponctuées
par quatre titres mondiaux), Valentino Rossi recherche un nouveau
challenge à 31 ans déjà. L’opportunité de travailler avec
Filippo Preziosi, la difficile relation entretenue
avec Jorge Lorenzo pendant près de trois ans et le
défi 100 % italien furent autant de raisons qui poussèrent
« The Doctor » à choisir la firme de Borgo Panigale. Bien
sûr, certains évoqueront sans doute le salaire mirobolant, mais ça
n’est pas de notre ressort. Lui même avoua que ça n’était pas sa
motivation première, et que Yamaha proposait tout autant.
S’en suivit deux années passées avec Ducati, en compagnie du
champion
du monde 2006 Nicky Hayden, avant de retourner chez
Yamaha.
II) L’échec cuisant, ou « échelle des
grandeurs »

Le Mans 2011, l’un des trois podiums de Valentino Rossi en rouge. Photo : Box Repsol
Avant de nuancer notre propos, revenons sur ce qui n’a pas
fonctionné. À vrai dire, nous pourrions passer des heures
à discuter des détails, de la relation parfois houleuse avec
Ducati, des difficultés rencontrées avec le développement de la
Desmosedici, pour, ensuite, en débattre. Mais si on prend un peu de
recul, cela ne fait aucun doute : la course au titre était
visée, et il a échoué sur ce plan. À l’époque, on pensait
réellement que Valentino Rossi pouvait faire triompher la belle
rouge, d’autant plus que ce transfert était l’un des plus
importants de l’histoire.
Un génial italien sur une machine de la botte, cela faisait
naturellement penser à l’association dorée Agostini/MV
Agusta. Toute l’image, la communication (jusqu’à la
livrée de sa machine, différente de celle de
Hayden en 2011) n’ont pas eu leur équivalent en
résultats. Aucune victoire en deux ans, alors qu’il était sacré
deux saisons auparavant, et seulement trois podiums. C’est
maigre.
Factuellement, il n’a pas assuré son statut d’homme
providentiel. Car oui, c’est une donnée à prendre en
compte. Si aujourd’hui, nous avons en mémoire des années blanches
de VR46, ça n’était jamais arrivé avant. Quand il signe avec
Ducati, Rossi réussit tout ce qu’il entreprend. Son passage chez
Yamaha, alors que la marque n’avait pas un palmarès aussi
prestigieux, était quasi-miraculeux. Rossi renvoyait l’image de
quelqu’un qui n’échouait pas, qui restait charismatique en toutes
circonstances, qui réussissait l’impossible, comme à
Phillip Island en 2003 ou à
Welkom en 2004. De ce point de vue, son transfert est
un échec, car le mythe était écorné, et nous nous sommes aperçus
qu’il était humain. Mais cette différence entre les
attentes et le résultat final n’a fait qu’amplifier le
phénomène.
III) Relativiser
Maintenant, prenons un peu de recul. Si nous ôtons un peu la
grandeur de cette signature et son impact historique, et que nous
étudions les résultats de près, ce n’est pas tant un échec. Tout
d’abord, il faut rappeler un point précis que beaucoup ont oublié.
À l’époque, les comparaisons avec Casey Stoner
allaient bon train, d’autant que les deux larrons avaient des
antécédents : Inutile de vous rappeler la course de
Laguna Seca en 2008… Stoner, doté d’un talent naturel
et d’une vitesse foudroyante, avait réussi à faire triompher la
Ducati. On se remémore l’Australien comme étant le seul à pouvoir
faire fonctionner cette machine, et ce n’est pas faux… Mais
quelque peu exagéré. En effet, la Desmosedici de 2011
n’avait plus rien à voir avec celle de 2007. Avant même l’arrivée
de l’Australien dans l’équipe officielle, Capirossi
arrivait à remporter des courses, et même à bien figurer
au classement général. La performance de la machine avait
considérablement régressé entre-temps. Oui, Casey parvenait à la
faire gagner entre 2008 et 2010, mais beaucoup moins souvent, et ne
jouait plus rien au général même en 2008, vice-champion à
93 points de Rossi.

La relation entre les deux avait été abîmée après l’accrochage de Jerez en 2011. Photo : Box Repsol
Par le fait, attendre un titre de la part de Rossi alors que Stoner
n’arrivait plus à performer durant une année complète à son guidon
(4e à 158 points du sacre en 2010) sur une machine
qu’il avait lui même façonnée, était sans doute trop présomptueux.
De plus, dans les faits, les deux saisons en question n’ont pas été
si mauvaises si l’on omet les attentes, justifiées à l’époque.
Rossi a réalisé quelques belles percées, et son podium au
Mans en 2012 est un vrai bijou. L’Italien a dominé son
coéquipier sur les deux années, notamment la seconde, et a marqué
une véritable progression sur une période finalement assez
courte.
Il faut aussi rappeler que le monde des Grands Prix était
différent.
L’électronique n’était pas partagée par tout le
plateau, ce qui contribuait aux écarts massifs entre
les différentes forces en présence. Cela fait de la période
2007-2015 l’une des plus difficiles pour s’imposer de toute
l’histoire, c’est un fait. D’ailleurs, il faudra attendre 2014 et
Andrea Dovizioso pour voir une meilleure saison,
preuve que le chantier laissé fin 2012 n’était pas facile à manier,
mais ça, Rossi n’y était pas pour rien.
Si l’on part de ce principe, ses saisons n’étaient pas pire que
celle de Jorge Lorenzo en 2017, année pourtant
bien plus ouverte, ou que Pedrosa en 2018 sur la fin de sa
carrière.
Conclusion :
Rossi chez Ducati, tout un débat. Finalement, et
contrairement à ce que l’on pourrait penser, il s’agit plus d’une
déception que d’un échec cuisant. Les attentes étaient tellement
élevées, normales, pour Vale’. Dans les faits, impossible
de dire que c’est une réussite, notamment à cause de l’absence de
titre mondial.
Il n’y pas de bonne ou de mauvaise réponse quant à cette
interrogation, car ce n’est qu’une question
d’interprétation surtout quand cela touche à un pilote aussi
clivant que Valentino Rossi. Mais nous sommes curieux de savoir ce
que vous en pensez ! Dites-le nous en
commentaires !

La différence de taille avec les machines actuelles est juste folle. Photo : Raniel Diaz
Photo de couverture : Matt Billings